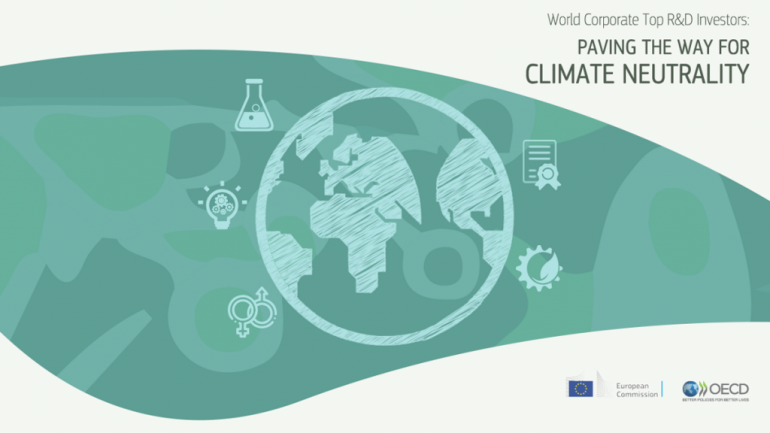Un.e tunisien.ne sur deux se nourrit actuellement de l’étranger. Notre dépendance alimentaire dépasse déjà les 55% de nos besoins. Pourtant, cette situation ne correspond à aucune fatalité. Contrairement à ce que la grande majorité des experts et des décideurs affirment, contre toute évidence, la Tunisie dispose de suffisamment de ressources naturelles (eaux, terres…) et humaines (savoir.s faire paysans extrêmement riches) pour nourrir la totalité de sa population actuelle et probablement plus.
Cela fait des décennies que la Tunisie s’enfonce, année après année, dans une dépendance alimentaire de plus en plus étouffante. Après 2011, nous étions nombreux à souhaiter un changement de cap et à espérer une rupture totale avec les politiques suivies depuis l’indépendance. Hélas, tous les gouvernements qui se sont succédé ont poursuivi aveuglément les politiques de leurs prédécesseurs dans une fuite en avant vers l’inconnu et contre les intérêts vitaux du pays.
Cette écrasante dépendance alimentaire risque de s’aggraver davantage si les accords de l’ALECA avec l’Europe étaient signés et approuvés par les décideurs politiques du pays. Notre marché agricole et alimentaire serait totalement ouvert aux producteurs et distributeurs européens, pendant que l’accès de nos produits agricoles et alimentaires sur le marché européen resterait soumis à des barrières douanières draconiennes. Au mieux, nous continuerons à subir, sans capacités de réactions, les conséquences des politiques de « désavantages » comparatifs. Nous continuerons à exporter les entrées, les desserts et l’huile d’olive, produits grâce aux soleil généreux, à l’exploitation des ressources naturelles locales (la terre, l’eau…), à la politique des bas salaires et à l’injustice et l’inégalité foncières. En contrepartie, nous poursuivrons les importations massives des céréales qui constituent la base de l’alimentation de tou.te.s les tunisien.ne.s.
Si par malheur, nos choix politiques, quels qu’ils soient, ne correspondaient plus à ceux de nos « amis » occidentaux et aux Institutions Financières Internationales (IFI), nous n’aurions plus que nos doigts à manger. Les évènements géopolitiques récents dans le Monde Arabe (Irak, Syrie, Soudan, Libye, Yémen,…) prouvent, d’une manière irréfutable et incontestable, qu’un embargo commercial, y compris alimentaire, ne demande que quelques jours à être décidé et à se mettre en place. Les conséquences sociales, politiques et même sécuritaires d’un tel scénario seraient absolument terribles pour l’ensemble des citoyen.ne.s.
Paradoxalement, les négociations actuelles autour de l’ALECA constituent la preuve éclatante de notre dépendance alimentaire. Certain.e.s, et j’en fais partie, poussent les négociateurs et le gouvernement à rejeter ces accords. C’est une position politique de principe que je continue à défendre. Mais avons nous conscience qu’un tel choix aussi radical nous couterait extrêmement cher ? Si signer les accords de l’ALECA aggraverait certainement notre dépendance alimentaire, ne pas signer risquerait de se transformer en un véritable cauchemar social, économique et politique. Face à un refus des accords de l’ALECA, l’Europe et le marché alimentaire mondial ne resteraient pas sans mesures de rétorsion pouvant aller jusqu’à la fermeture totale des marchés internationaux aux produits tunisiens. Les pertes se compteraient, alors, par milliards de dollars ce qui nous plongerait dans une crise économique d’une ampleur jamais connue jusqu’ici.
C’est évidemment contradictoire. Signer l’ALECA serait une honteuse soumission sans résistance. Ne pas signer, serait une prise de risques considérable, si une telle décision n’était pas immédiatement accompagnée par d’adoption, en urgence absolue et toute affaire cessante, d’une nouvelle politique agricole alimentaire qui rompt définitivement avec la politique actuelle. Un tel changement doit à la fois rompre avec le principe des « avantages comparatifs » et se baser sur ce principe simple dans sa formulation et relativement aisé dans son application : « Les ressources naturelles, dont la terre et l’eau, doivent d’abord servir à nourrir la population ».
Le changement de paradigmes devient une urgence
Loin de vouloir revenir à la politique des coopératives des années 1960, ce changement de politique agricole et alimentaire ne demande que deux décisions politiques courageuses et volontaristes : 1) Sortir le secteur agricole de la sphère des investissements capitalistes et spéculatifs, à la recherche de bénéfices financiers ; 2) Remettre les paysans et les paysannes, aujourd’hui stigmatisé.e.s, appauvri.e.s défavorisé.e.s et marginalisé.e.s, au cœur de l’agriculture tunisienne. Ils et elles en ont besoin et l’ensemble du pays a besoin d’eux et d’elles. Il ne s’agit pas de les prendre en charge et encore moins de les assister, mais de leur rendre les clés du secteur et de leur redonner la fonction principale qui consiste à nourrir les humains et à protéger nos ressources naturelles et notre environnement. Il ne s’agit que de leur redonner leur dignité dont ils/elles sont dépossédé.e.s.
Aujourd’hui, 3 % des producteurs agricoles ont plus de 100 hectares chacun, s’accaparent plus de 30 % de la terre agricole utile et produisent essentiellement pour les marchés étrangers (pas tous bien sûr). En même temps, 97 % des agriculteurs dont les exploitations mesurent moins de 100 hectares, n’occupent que les 2/3 restants de la terre agricole et produisent, pour la plus part, pour les marchés locaux et/ou nationaux, pour les plus grands d’entre eux. Précisions encore que 75 % des agriculteurs tunisiens possèdent moins de 10 hectares, n’occupent collectivement que 25 % de la terre agricole totale et ne produisent exclusivement que pour le marché local et national. A eux seuls, ces chiffres expliquent en très grande partie la dépendance alimentaire du pays, puisque une grande partie de la terre agricole produit essentiellement pour des marchés extérieurs.
Seule une réforme agraire volontariste peut corriger ces inégalités injustes et pénalisantes.
Cela doit passer par une réforme agraire radicale qui fixe des seuils minimums et maximums à la propriété agricole, maitrise les mécanismes des marchés fonciers, agricoles et alimentaires, interdit, par un système de taxation adéquat, les investissements spéculatifs dans le secteur agricole et alimentaire et réoriente la production agricole vers les marchés locaux et nationaux au détriment de l’export vers les marchés internationaux que les pouvoirs actuels continuent à favoriser.
Dans un pays économiquement dépendant, comme le notre, le secteur agricole est un secteur économiquement et politiquement stratégique. Il doit être sanctuarisé. Tous les pays du Nord sanctuarisent leur secteurs agricoles et protègent leurs propre marché agricole par des barrières douanières infranchissables. Peu de pays au monde subventionnent leurs agriculteurs autant que les Etats Unis et l’Europe. Rappelons nous bien que le Traité de Rome, signé le 25 mars 1957 à Rome (Italie), entre six pays (Allemagne de l’Ouest, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas) visait notamment la création du « marché économique européen » et est né de la prise de conscience de quelques chefs d’Etats européens de la nécessité de sanctuariser leur secteur agricole européen face aux pressions étrangères et notamment américaine.
Aujourd’hui, les politiques agricoles en Tunisie font tout le contraire : dé-sanctuariser le secteur agricole tunisien. Un aveuglement criminel et irresponsable. Une menace lourde sur les générations actuelles et les générations futures. Une honte.
Il ne m’échappe pas que l’expérience catastrophique des coopératives des années 1960 qui portait en elle les raisons intrinsèques de son échec, même sans les enjeux politiques qui ont accéléré la chute de son promoteur, Ahmed Ben Salah, a rendu toute idée de réforme agraire inaudible et impensable pour la plus grande partie de la population et des élites politiques et économiques du pays. Pourtant, deux autres expériences mériteraient que l’on s’y intéresse de plus près, avant de rejeter en bloc toute réflexion et/ou proposition de réforme du foncier agricole et plus généralement des structures agraires.
Le premier exemple est celui de la réforme agraire que les Etats Unis, leader et gardien du monde capitaliste, ont imposée à la Corée du Sud, au lendemain de la guerre de Corée. Son objectif principal (pas le seul) était que les Coréens du Sud produisent eux mêmes leurs besoins alimentaires au lieu de dépendre de l’aide alimentaire américaine et occidentale. Ce fut incontestablement une réussite qui a participé à l’apparition du « miracle » coréen que l’on connaît aujourd’hui. Marx, n’était en rien responsable de cette expérience menée par la première puissance capitaliste du monde dans un pays qui, à la sortie de la guerre, se lançait corps et âme dans une trajectoire capitaliste libérale. Les libéraux tunisiens qui prennent un air offusqué et effarouché dès qu’ils entendent l’expression « réforme agraire », devraient lire davantage sur l’histoire du capitalisme et de l’idéologie à laquelle ils s’identifient…
La seconde expérience est l’expérience incontournable de Cuba. Soumise à un embargo commercial et alimentaire draconien, imposé par son grand voisin américain dès le lendemain de la révolution castriste, Cuba a mis en place, surtout à partir du début des années 1990, une réelle politique de souveraineté alimentaire basée sur a) une réforme du foncier agricole et des structures agraires basée sur un principe simple : « la terre à ceux et celles qui la travaillent pour se nourrir et nourrir la population ». Ce choix a permis au pays, que les USA voulaient littéralement asphyxier pour éviter toute « contagion » marxiste, non seulement d’éviter la famine mais aussi de réduire drastiquement sa dépendance alimentaire envers l’extérieur et donc les risques de pressions politiques de ses ennemis comme de ses amis ; b) la limitation draconienne de tout usage des pesticides avec un double objectif : renforcer son indépendance vis à vis du marché mondial des produits chimiques à usages agricoles et éviter les effets de ses produits toxiques sur la santé des producteurs et des consommateurs. Le monde entier connaît les réussites indéniables du système de santé cubain qui situe la population locale en haut de l’échelle de l’espérance de vie à la naissance ; c) la pratique systématique de l’agro-écologie pour protéger les sols agricoles contre l’épuisement et la stérilisation que provoquent les monocultures. Toutes les études et recherches disponibles montrent que, grâce à ces différentes réformes, l’agriculture cubaine est devenue plus productive qu’elle ne l’a été avec les modèles productivistes. Aujourd’hui, Cuba est reconnue comme un modèle de souveraineté alimentaire. Mieux encore : grâce à l’aide et directe et indirecte de Cuba, plusieurs pays africains ont pu éviter des famines certaines que les puissances occidentales n’auraient pu ni éviter ni juguler.
Certes, la Tunisie n’est ni la Corée du Sud ni Cuba et les contextes géopolitiques sont totalement incomparables. Il ne s’agit donc en aucun cas d’importer l’une ou l’autre de ces deux expériences, mais de s’en inspirer « politiquement » et d’en tirer quelques éléments positifs pour imaginer des solutions locales, qui tiennent compte du contexte géographique, agricole, écologique, social, économique et politique de la Tunisie, afin de consolider la souveraineté alimentaire du pays et de réorienter les politiques agricoles et alimentaires vers plus d’indépendance alimentaire, plus de justice sociale et environnementale et moins de risques écologiques, économiques et politiques.
Un secteur agricole développé, débarrassé des investissements spéculatifs et orienté à la fois vers la souveraineté alimentaire et le droit des générations actuelles et des générations futures à une alimentation suffisante, équilibrée, saine et protectrice de l’environnement, … est un secteur qui garantit une réelle sécurité alimentaire pour les producteurs, comme pour les consommateurs, protège les ressources naturelles et la biodiversité et attire les jeunes, aujourd’hui ruinés par le manque d’emplois et d’opportunités et largement poussés vers des solutions extrêmes et souvent suicidaires. La souveraineté alimentaire crée un lien organique entre les producteurs et les consommateurs et les intègre dans un model qui « protège » les intérêts des deux parties.
C’est ce que les décideurs politiques actuels rejettent sans même prendre le temps d’en discuter et d’en débattre. Notre devoir est de les amener par tous les moyens, de préférence pacifiques, à accepter le débat, la confrontation et l’argumentation politique, basée sur des analyses des divers processus en cours dans le secteur agricole.
C’est ce que nous exigeons et appelons de nos veux pour plus d’indépendance alimentaire et plus du respect fondamental à l’alimentation. C’est ce qui nous semble urgent et indispensable si l’on veut à la fois réduire la marginalité sociale rurale et urbaine, offrir des opportunités aux jeunes générations, protéger notre environnement, nous prémunir des conséquences catastrophiques des changements climatiques en cours, réduire notre exposition aux pressions étrangères et laisser une Tunisie et un monde meilleurs aux générations futures.
La sortie de l’ALECA et plus généralement du marché alimentaire mondial est une urgence absolue. Mais en sortir sans réformes radicales de nos politiques agricoles reviendrait à sauter du haut d’un gratte-ciel sans aucun filet de protection.
Nous pouvons nous orienter vers une souveraineté alimentaire réelle qui ne peut être réduite à aucune forme de chauvinisme ou de nationalisme aveugles et suicidaires. Fermer totalement portes et fenêtres, c’est se condamner à mourir d’asphyxie et d’étouffement. Les ouvrir complètement c’est prendre le risque d’être emportés par les courants d’air.
Exigeons un changement radicale de nos politiques agricoles et alimentaires pour plus de souveraineté individuelle et collective, plus de dignité, plus de sécurité et plus de justice sociale, économique, environnementale, régionale et intergénérationnelle. Nous pouvons le faire. Nous devons le faire.